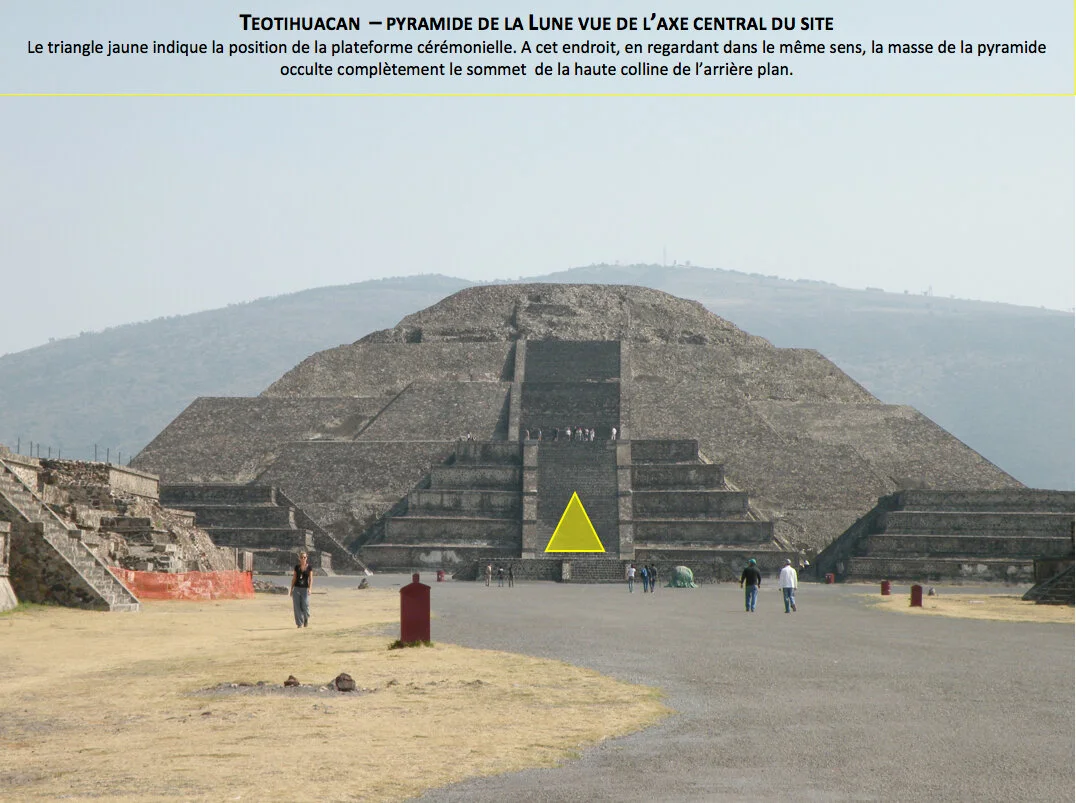"AU PAYS DU MATIN CALME" - CHRONIQUE D’UNE VISITE DE TRAVAIL EN CORÉE DU NORD FIN SEPTEMBRE–DÉBUT OCTOBRE 2014
Connaissance & Partage
"AU PAYS DU MATIN CALME" - CHRONIQUE D’UNE VISITE DE TRAVAIL EN CORÉE DU NORD FIN SEPTEMBRE–DÉBUT OCTOBRE 2014
Au retour d’une plongée de deux semaines dans cette "effroyable contrée à la limite du monde civilisé, chez des jaunes bridés, uniformisés, robotisés, et prêts à nous irradier tout crus", je me suis imposé de raconter ce que j’ai vu, non pas pour prendre leur défense, mais pour essayer de comprendre, et de redresser un tant soit peu une image désastreuse. Franchement je m’attendais à des conditions de travail très dures pour cette mission rare, assorties d’une inquiétude permanente concernant la sécurité. Et j’en suis revenu en pleine forme... sans avoir été inquiété. Entre parenthèses, je m’efforcerai de tirer quelques leçons que notre société dite libérale et démocratique ferait bien de méditer, car nous aurions beaucoup à profiter de certaines inventions ‘made in North Korea’. Par exemple le respect pour les leaders... Enfin, un minimum de respect….
La population totale est autour de 24 millions, (50 en Corée du Sud), en majorité urbaine (60%), et elle vieillit assez vite, en raison de la fécondité basse. Malgré les ‘directives officielles’ encourageant les familles à avoir plus de deux enfants, il semble y avoir de la résistance, le taux de natalité restant au dessous du seuil de remplacement. Le gouvernement est préoccupé par ce fait, car les effectifs de l’Armée (presque la moitié de la population adulte masculine) risquent de diminuer. Nos programmes favoris de planification familiale trouvent vite leurs limites, et l’IVG est courante. Les statistiques et indicateurs concernant la population, justement, puisqu’il faut en parler, laissent à désirer. Les données brutes du recensement sont ‘secret d’état’, non accessibles aux étrangers, de même que la plupart des statistiques sociales et économiques. Il faut croire les autorités, ou ne pas rester. Pour les démographes comme moi, c'est une insulte, et je le leur ai dit dans mon rapport de debriefing. Si on ne peut pas interroger la population, comment savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, ce qu'elle veut?
Le problème pour le visiteur, c’est qu’on a du mal à pénétrer la société nord-coréenne. On voit beaucoup de gens se déplacer, mais on ne sait pas exactement ni d’où ils viennent, ni où ils vont. Des expatriés présents depuis de nombreuses années (oui il y en a, le champion que j’ai rencontré, un allemand ex de l’Est, est là depuis 11 ans !) indiquent que la société est fortement hiérarchisée, au contraire des déclarations officielles. Le Peuple aurait le Pouvoir, mais certainement ne l’exerce pas. Le subit’ il ?
Au sommet de la hiérarchie le Leader Eternel, Kim Il Sung, le père Fondateur, qui n’est pas mort en 1994 mais s’est simplement désincarné. Son ombre et sa présence paternelle couvrent la société toute entière. Son année de naissance, 1912, est marquée comme le début de l’ère Juché, nous sommes donc en 102 de l’ère Juché. Ses portraits géants, ses statues aussi géantes, en compagnie de son fils le Généralissime Kim Jong il (1942-2001) qui lui a succédé en 1994, émaillent le paysage, en ville comme à la campagne. Ses écrits philosophiques, politiques et sociaux, ainsi que ceux de son successeur sont distribués, lus et commentés ad libitum et ad nauseam.
Juste au dessous des Leaders éternels, les caciques du régime, organisées en Présidium de l’Assemblée Suprême du Peuple, de la Commission Nationale de Défense, de l’Armée Nationale Populaire, et du Cabinet (Conseil des Ministres). Il y a donc beaucoup de caciques, et leur caste s’auto entretient naturellement, tandis que leurs enfants ruent dans les brancards et font parfois scandale lors de leurs frasques ou de leurs voyages à l’étranger. Frasques que leurs vieux pères essaient de déguiser comme ils peuvent. Au niveau provincial, les Comités Populaires du Peuple répliquent la hiérarchie de pouvoir du niveau central, et ainsi de suite jusqu’au niveau des communes rurales ou urbaines. Des représentants de ces Comités accompagnent systématiquement les fonctionnaires des ministères, qui leur sont inféodés, et exercent un contrôle strict des fonctions administratives, économiques, éducatives, sociales, sanitaires etc. Par exemple si vous invitez un technocrate à participer à un séminaire de formation à l’étranger, il ne pourra pas se déplacer sans être accompagné d’un mentor politique, qui le contrôlera tout au long du séjour, et occupera un budget de formation parfaitement inutile. Si vous invitez une femme, elle devra obligatoirement être chapeautée par une femme du Parti. Jamais une Nord-Coréenne ne sera autorisée à voyager seule à l’étranger, ce serait trop dangereux...
Au milieu de l’échelle, les intellectuels, très prisés par le gouvernement à condition qu’ils mettent leurs capacités au service de l’idéologie unique. Ils sont très surveillés car ils pourraient bien jeter les bases de la création d’une classe moyenne, ce qui serait aussi trop dangereux. Enfin, au bas de la hiérarchie sociale, les travailleurs des usines, des fabriques, des coopératives rurales, l’immense majorité du petit peuple, éduqué certes, mais maintenu dans l’incapacité de penser autrement, en tous cas d’agir autrement qu’en fonction des directives. Chaque unité de production a un plan de rendement annuel, imposé par le Parti, et doit s’y tenir à tout prix. Ce n’est que s‘ils se débrouillent bien pour produire un surplus qu’ils sont autorisés à réinvestir dans la modernisation des outils de production. Sinon tant pis pour eux.
Bien entendu, on ne passe pas d’une catégorie sociale à une autre. On nait, grandit, travaille, et meurt dans son groupe, sans espoir de prendre l’ascenseur social. Ce que nous ne savons pas, c’est ce qu’il advient des réticents, des résistants, des défaillants, des divergents... Il doit bien y avoir des manières de les faire revenir dans le droit chemin, pour le plus grand bien de leur patrie. Mais notre connaissance de ces manières s’arrête vite.
LA Ville, c’est Pyongyang. Un fantastique arrangement urbanistique de bâtiments officiels (qui ne portent pas de nom car tout le monde sait ce qu’ils sont), de monuments monumentaux, et d’immeubles d’habitation répétés à l’infini. On parle souvent de ‘Manhattan’. Parcouru d’avenues immenses, rectilignes, de 6 à 10 voies (chacune caractérisée par un vitesse limite différente), avec des carrefours sans feux rouges (très peu, et non respectés par les convois officiels), des agentes de police à chaque coin de rue, s’agitant comme des robots avec leur bâton lumineux. Peu de circulation, pas d’embouteillages, pas de voitures privées (sauf les hommes d’affaires étrangers et les véhicules diplomatiques), des camions polluants, des bus bondés, des trolleys brinquebalants, des tramways grinçants, des vélos à gogo, mais surtout des piétons, des milliers de piétons. Nous n’avons vu que les deux stations de le métro accessibles aux étrangers, mais il paraît qu’il est très fréquenté, avec des tickets à 0,05 euro.
Attention, priorité aux véhicules à moteur, en toutes circonstances ! Si vous envisagez de traverser, même sur les passages zébrés, assurez-vous que pas un véhicule ne vient vers vous, vous devrez immédiatement reculer et revenir sur le trottoir, sans protester. Il paraît que cela tient du respect que la culture nationale impose pour ceux qui détiennent le pouvoir (donc qui roulent en voiture).
Pas de boutiques le long des rues, ni de publicités, mais des slogans, des posters et des statues officielles à foison, ce qui rend la ville très colorée. Parmi les monuments saillants, le gigantesque Hôtel Ruygyong, pyramide de près de 300 mètres visible de partout, dont personne ne parle parce qu’il symbolise un échec : Bien que commencée dans les années 80, cette gigantesque structure qui devait être l’Hôtel le plus haut du monde a subi une série de revers architecturaux et de retards conséquents, bref il est toujours en travaux (il paraît que Lafarge a pris une part du contrat) et ne sera pas ouvert avant longtemps.
Ce qui frappe dans la population de Pyongyang, c’est qu’elle est presque uniformément composée de la classe d’intellectuels : fonctionnaires, étudiants, dirigeants. Toutes les femmes portent une tenue impeccable, jupe droite noire et talons hauts, coiffure soignée et maquillage, et les hommes une veste. Les écoliers et étudiants sont tous en uniforme avec cravate, et leurs professeurs tirés à quatre épingles, respect aux intellectuels. Le port du ‘bouton patriotique’ est obligatoire, un petit pin à l’effigie des Leaders épinglé sur la poitrine de tout citoyen, et garant de sa fidélité. Le civil qui n’en porterait pas serait immédiatement repéré et sujet à des ennuis considérables, allant jusqu’à l’exclusion. Les militaires n’en n’ont pas besoin, toute leur tenue témoignant de leur affiliation. Ils sont absolument partout, dans leurs uniformes kaki à galons dorés.
Dans tout le pays les enfants sont rois : il y a des jardins d’enfants dans tous les quartiers et les coopératives, des événements organisés pour eux, et bien sûr des références à l’Armée dans tous leurs jeux. Pour des raisons restées obscures, Il y avait beaucoup d’orphelinats dans les villes. On dit que maintenant la population d’orphelins a diminué, mais allez savoir. Les ONGs caritatives internationales, surtout celles pilotées par la Corée du Sud et les Eglises protestantes, se sont emparées du problème, ce qui a sans doute incité les autorités à le minimiser, en faisant tomber les statistiques. L’éducation est obligatoire pendant 12 ans, donc jusqu’à 16-17 ans. Après, les infants des intellectuels iront à l’université ou dans les collèges professionnels ou dans les collèges d’officiers, les autres à l’armée pendant 5 à 10 ans de service obligatoire. L’université Kim Il Sung est la plus ancienne et la plus grosse du pays, fondée en 1946. Son bâtiment phare à 22 étages se voit de partout. Bien entendu les jeunes Coréens s’initient au jeu de Go dès leur premier âge : jeu de stratégie indispensable. De même pour le ping-pong, et le Taek Won Do (qui est né en Corée).
La santé est gratuite pour tout le monde, et le réseau de structures de santé assez dense, mais il reste des grosses questions sur la qualité des soins. On nous dit que toutes les femmes viennent accoucher dans les hôpitaux, mais un coup d’œil aux maternités explique vite pourquoi elles n’y restent pas plus que quelques heures, surtout en hiver...
Il y a de la pollution à Pyongyang, en raison de l’absence de vent, et en hiver du chauffage au charbon universel. Les bâtiments sont presque tous chauffés par le sol, par des tuyauteries d’air chaud provenant de chaufferies au charbon. Inutile de dire que les cheminées ne sont pas dotées de filtres à particules, pas plus que les véhicules. Ajoutons à cela le fait que 95% des hommes fument (par principe autant que par besoin), le taux de tumeurs cancérigènes ne doit pas être faible.
Encore un exemple de l’étanchéité des classes sociales, la population urbaine est strictement contrôlée: on ne vient pas s’installer à la capitale depuis les campagnes, des check-points sont installés sur toutes les routes d’accès et ne sont autorisés en ville que les gens qui ont une justification. Nés paysans vous devez le rester... Un exemple des échanges ville-campagne, c’est le marché. Il paraît qu’il n’y a des marchés publics que depuis peu. Un seul est ouvert aux étrangers, à condition de ne pas y prendre de photos (c’est bien dommage). On y trouve, sous un immense hall très structuré, avec gardes et contrôleurs partout, des rangées de vendeuses en uniforme, armées de calculettes, assises devant les étals de viande, fruits, légumes, ustensiles, outils, biens de consommation courante dont on ne sait pas l’origine. On discute les prix avec l’une ou l’autre des vendeuses, mais on n’a pas l’impression que les articles en vente leur appartienne, en tous cas elles ne se comportent pas comme si leur vie en dépendait. Elles doivent sans doute remettre le produit de leur vente à la fin de la journée, comme les employés remettent leur salaire. C’est la seule occasion dans Pyongyang où les étrangers (beaucoup de mamies Russes et Est Européennes, beaucoup de Chinoises) peuvent échanger des Won et payer en monnaie locale. Elles sont ravies.
Les autres villes du pays sont plus petites, plus à l’échelle humaine, plus cosmopolites aussi, en ce sens qu’on y rencontre des gens de toutes les classes sociales, y compris des paysans. Mais la structure de pouvoir est identique, et la présence ubiquitaire de slogans démontre la domination du politique.
Dans les capitales provinciales et les stations touristiques, des hôtels ouverts aux étrangers déploient des prouesses d’architecture et de tape à l’œil. Un soir que nous arrivâmes dans un de ces gigantesques établissements presque vide de clients, je m’installe dans ma chambre au 12ème étage et je reçois un coup de téléphone immédiatement. Je croyais que c’était la police qui voulait mon passeport, mais non, on m’annonce qu’en raison de notre arrivée tardive la politique de restriction d’eau chaude de l’hôtel vient d’être levée et ils remettent les chaudières en route pour nous. Cinq minutes après, l’eau chaude coulait. Pas d’ordinateurs pour gérer les réservations, mais tous nos déplacements doivent être planifiés et annoncés aux autorités locales au moins cinq jours ouvrés avant l’arrivée. Pas de place pour le débarquement surprise !
Vie quotidienne à la campagne, une autre histoire
Le réseau routier est dense, mais de piètre qualité. Autour de la capitale et entre les capitales de provinces, des ‘autoroutes’ (sans péage) très larges recouvertes de dalles de béton mal jointées (bonjour les reins). Les routes secondaires sont peu goudronnées et les chemins ruraux facilement boueux et garnis d’ornières, avec des charrettes à bœufs. On rencontre très peu de véhicules, et ce sont presque tous des utilitaires, des véhicules militaires, ou des transports en commun. De curieux camions qui portent une chaudière fumante sur leur plateau, on dirait qu’ils fabriquent eux-mêmes leur biocarburant... Enormément de véhicules en panne sur les bas- côtés, avec des gens en train de réparer. La règle est l’autonomie, vous dormez sur le bord de la route jusqu’à ce que vous ayez réparé. Pas de garages et pas de stations d’essence. Comment ça doit se passer en hiver, avec la neige? On voit beaucoup de vélos, et les cyclistes mettent le pied à terre dès que ça monte un peu, pas de dérailleurs, mais pas mal de chaines déraillées. Bien sûr, la traction animale reste reine.
Les bas-côtés des routes sont plantés de fleurs, pendant des kilomètres: du plus bel effet esthétique. Etait-ce une directive ?
Dès qu’on quitte la ville, on est dans les champs, pas de faubourgs. Et c’est le domaine des coopératives. Toutes sont annoncées par d’immenses panneaux portant des slogans en lettres blanches sur fond rouge. L’habitat est groupé, autour de l’obélisque central de la coopérative (slogans), avec des petites maisonnettes individuelles stéréotypées aux toits de tuiles, munies d’un jardin potager sur le devant.
C’était la saison de la moisson dans les rizières, et tout le monde participait. Fermes, vergers, rizières, unités de transformation, toute la société rurale est organisée en coopératives, et guidée par l’objectif suprême de l’indépendance alimentaire.
Hélas nous savons qu’elle est encore loin, et le pays ne survit qu’à travers des importations alimentaires massives. Des famines étendues ont été rapportées dans les années 80 et 90, déclenchant l’assistance internationale humanitaire, qui a du être prolongée jusqu’à nos jours, malgré les sanctions internationales La période sensible est en hiver, quand les réserves de riz ont été consommées, et qu’il n’y a plus de farine. On fait alors appel au maïs et aux pommes de terre. Les fruits, surtout les pommes, sont exportés et non consommés. Le légume roi est le choux, dont les coréens font grande consommation sous forme de ‘kimchi’, choux fermenté et pimenté servi au début de chaque repas, confectionné avec passion par toutes les ménagères et gardé en bocaux sur les balcons. Nous avons beaucoup discuté avec le patron du plus grand programme d’aide alimentaire (le PAM, Programme Alimentaire Mondial). Ils font des enquêtes nutritionnelles tous les deux ans et parent au plus urgent, avec une immense carte murale des déficits nutritionnels devant eux, mais les petits Coréens des campagnes resteront petits toute leur vie. Signe de malnutrition chronique.
Très peu de machines, malgré les déclarations comme quoi le pays produit toutes les machines nécessaires. Il faut croire que les tracteurs et autres machines agricoles ne sont pas nécessaires. Beaucoup de travaux s’effectuent à la main, comme par exemple la construction de la nouvelle piste de l’aéroport. Pelle, pioche, sacs de jute, un travail titanesque, apparemment conduit dans l’enthousiasme: bientôt une nouvelle piste pour faire décoller nos Leaders, et augmenter la fierté nationale
Les vendredis après midi sont consacrés à l’éducation politique : des débats et des conférences sont organisés sur les lieux de travail, tandis que les samedis sont consacrés aux travaux d’intérêt général, entretien des rues et des parcs, propreté des locaux de travail. On peut voir des milliers d’étudiants tondre le gazon de leur université à la main un samedi matin, c’est bon pour la tête, et pour la cohésion sociale. Les restrictions d’électricité fréquentes dans les quartiers imposent aux étudiants d’aller le soir étudier sous les réverbères de leur quartier. C’est assez romantique.
La télévision, reine des médias ? Seulement en ville, et là où les réseaux hertziens portent les ondes. Il n’y a que deux chaines nationales et bien sûr pas de chaine privée. L’une pour les informations (si vous voulez tout savoir des mouvements des dirigeants et des visites officielles) l’autre pour la culture populaire (films faits maison, retransmission de cérémonies et de performances artistiques et sportives, mouvements de masse). Le problème est que vu la faible quantité de programmes mis à la disposition des chaines, les mêmes images reviennent en boucle tout le temps. C’est ce qu’on appelle la chaine d’information en continu.
Difficile de savoir si les journaux pour le peuple sont très lus. Il est possible que tout le monde en connaisse à l’avance le contenu. En tous cas ils sont en coréen. Une publication hebdomadaire en anglais, le Pyongyang Times, renseigne les étrangers sur les événements nationaux et commentent l’actualité internationale du point de vue national, ce qui apporte un éclairage inattendu sur les grandes questions internationales. Les Américains, ennemis héréditaires, comme les Japonais, n’y sont pas à la fête...
Venez découvrir la Corée du Nord avant que les touristes ne viennent la polluer ! Vous serez choyés, accompagnés, guidés, informés, traduits. On s’assurera que toutes vos questions ont une réponse (mais vous ne pourrez pas les poser à l’homme de la rue). On vous dira ce qu’on peut photographier et ce qu’on ne peut pas, et vous aurez intérêt à vous y conformer, sous peine de crise diplomatique. On vous dira quels hôtels et quels restaurants vous sont accessibles sans problème. On vous dira ce que vous pouvez acheter, et les prix en euro. On vous dissuadera de faire du stop, et de vous perdre dans les marchés. A ces conditions vous apprécierez beaucoup votre voyage, et vous aurez vu ce que les autres ne voient pas...
Evidemment, si vous avez l’esprit obtus et des préjugés politiques (comment peut-on être Nord-Coréen ?), mieux vaut éviter le déplacement...
Peut-on conclure après un séjour, même professionnel, de deux semaines seulement ? On ne revient pas d’un séjour en Corée du Nord tout à fait le même. On a vu pendant deux semaines, sans vraiment la partager, la vie de gens à priori comme nous mais qui ont un passé, un présent, un avenir complètement différent des nôtres. Les rapports de Human Rights Watch et autres organisations basées en Corée du Sud racontent des choses terribles sur les détentions arbitraires, les camps de rééducation, les ‘disparitions’. Le tout fondé sur les déclarations des réfugiés. Il y a certainement du vrai. Il y a d’autres exemples de régimes arbitraires. On pourrait commencer par essayer de comprendre la volonté d’indépendance, le besoin d’exister sans le contrôle du capitalisme international. La Corée du Nord a adhéré aux Nations Unies en 1991. C’est une nation-sœur. Faut-il la vouer aux gémonies ? Ce serait vouer vingt-quatre millions de personnes, qui souffrent terriblement des effets des "sanctions". Peut-on dialoguer dans un esprit d’ouverture ?
Vincent Fauveau